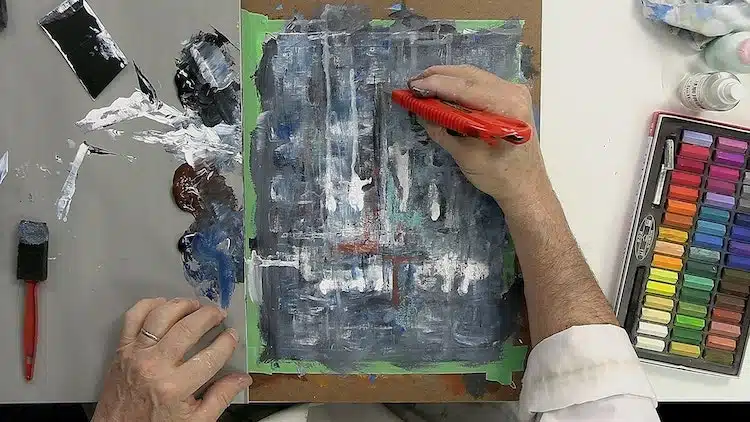En 2023, 80 % des besoins énergétiques mondiaux restent couverts par des ressources fossiles. Pourtant, plusieurs grands constructeurs automobiles annoncent l’abandon progressif des moteurs à combustion interne dans les dix prochaines années. Les investissements publics et privés dans les technologies de l’hydrogène ont triplé depuis 2018, sans pour autant bouleverser le marché.
La question de la compétitivité de l’hydrogène face aux énergies fossiles suscite des positions divergentes au sein de l’industrie comme des gouvernements. Les enjeux économiques, environnementaux et stratégiques s’entrecroisent, rendant les choix technologiques plus complexes que jamais.
Le pétrole face à la montée des alternatives énergétiques
Le pétrole conserve son emprise sur la planète. D’après l’Agence internationale de l’énergie (IEA), il compose, avec le gaz naturel et le charbon, l’ossature d’un système façonné par les combustibles fossiles. Mais cette domination subit de fortes secousses. Les impératifs climatiques, la nécessité de bifurquer vers un autre modèle, mettent sous pression une industrie longtemps intouchable.
Les émissions de gaz à effet de serre liées au pétrole et au gaz naturel écornent leur position. La hausse continue du carbone dans l’atmosphère, régulièrement pointée par l’IEA, impose le débat dans les sphères politiques et industrielles. Impossible d’ignorer plus longtemps la réalité du dérèglement climatique. La France, comme le reste de l’Europe, accélère l’intégration des énergies renouvelables. Mais l’intermittence de l’éolien ou du solaire pose des défis pour la stabilité et la fiabilité du réseau.
Pour mieux comprendre les forces en présence, voici les caractéristiques principales des sources d’énergie actuelles :
- Pétrole : ressource accessible, réseaux développés, mais dépendance forte aux exportations et à la géopolitique.
- Gaz naturel : alternative transitoire, émissions moindres que le charbon mais toujours fossile.
- Renouvelables : progression rapide, mais stockage et continuité de service encore partiellement résolus.
Changer de cap vers un mix énergétique moins carboné n’a rien d’automatique ni d’instantané. L’Europe, France comprise, avance sans rupture radicale avec les énergies fossiles. Le débat sur le gaz naturel, qui oscille entre solution d’attente et piège de transition, reflète toute l’ambiguïté du moment. Les scénarios de l’IEA le rappellent : sans mouvement décisif, la neutralité carbone restera hors d’atteinte.
Hydrogène : fonctionnement, production et enjeux actuels
Impossible d’ignorer l’irruption de l’hydrogène dans la conversation énergétique. Ce gaz discret, ni couleur ni odeur, ne se trouve quasiment jamais à l’état pur : tout l’enjeu réside dans sa production. Deux méthodes dominent nettement aujourd’hui. Plus de 90 % de l’hydrogène mondial provient du reformage du gaz naturel, une technique rodée mais émettrice de carbone. En face, l’électrolyse de l’eau, alimentée par une électricité décarbonée, incarne la promesse d’un hydrogène décarboné, sans CO2 à la sortie, mais à un tarif encore élevé.
L’électrolyse repose sur un principe simple : un courant électrique sépare l’hydrogène et l’oxygène de l’eau. Mais derrière l’élégance de la réaction, la réalité économique s’impose : le coût de production reste un obstacle de taille, dépendant du prix de l’électricité et de l’efficacité des équipements. En France, le CEA, le CNRS, mais aussi des industriels tels qu’Air Liquide ou Siemens, investissent dans l’optimisation de la filière et dans la montée en échelle.
Pour clarifier les différences majeures, voici les principaux types d’hydrogène produits aujourd’hui :
- Hydrogène gris : issu du gaz naturel, il génère d’importantes émissions de CO2.
- Hydrogène vert : produit par électrolyse, alimentée par des énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien.
- Hydrogène bleu : obtenu par reformage du gaz naturel, mais avec capture du carbone pour limiter l’empreinte.
La France vise une production massive d’hydrogène décarboné, en ligne avec les ambitions européennes. Mais le coût, encore trop élevé, freine la généralisation. État et industriels cherchent à lever les barrières économiques, en misant sur la progression de l’électrolyse et sur le développement conjoint des énergies renouvelables.
Peut-on vraiment compter sur l’hydrogène pour la transition énergétique ?
L’hydrogène gagne du terrain dans la quête d’un système énergétique plus propre. Ce vecteur d’énergie multiplie les promesses : valoriser l’électricité excédentaire des énergies renouvelables, compenser l’intermittence, alimenter des piles à combustible dans les transports ou l’industrie. La France expérimente déjà, par exemple avec la SNCF qui teste des trains régionaux à hydrogène. Des sociétés comme Lhyfe et HySiLabs se lancent sur le marché de la production et de la logistique.
Mais la technologie n’est pas le seul défi. Le stockage, le transport et la distribution de l’hydrogène à grande échelle posent de vraies questions. Adapter les réseaux existants, garantir la sécurité des infrastructures, maîtriser la densité énergétique et la réglementation : chaque avancée technique soulève de nouvelles exigences.
Le soutien des pouvoirs publics s’intensifie. Le gouvernement français, avec l’Ademe, la BPI et l’ANR, mobilise des financements majeurs. Le Conseil national de l’hydrogène réunit industriels et chercheurs autour d’objectifs partagés. À l’échelle européenne, la dynamique s’accélère, tandis que le GIEC rappelle le rôle déterminant de l’hydrogène dans la décarbonation.
Perspectives et obstacles
Les principaux domaines d’application et défis à relever sont les suivants :
- Industrie : la décarbonation des filières acier, ammoniac, raffinage grâce à l’hydrogène s’organise.
- Mobilité : bus, trains, poids lourds, voitures : la filière démarre, mais reste à structurer.
- Europe, Japon, Australie, Allemagne : chaque pays avance à son rythme, entre coopération internationale et concurrence technologique.
Vers un futur plus propre : quelles perspectives pour l’hydrogène ?
L’hydrogène occupe désormais une place centrale dans les stratégies industrielles et politiques. Ses usages s’étendent, de la mobilité légère ou lourde à l’aviation bas carbone. Sur le terrain, la France multiplie les projets pilotes, notamment dans les transports collectifs ou l’injection dans les réseaux de gaz. L’industrie s’active : Airbus affiche ses ambitions pour l’aviation, EDF et Siemens testent la production d’hydrogène décarboné à grande échelle, alimentée par des énergies renouvelables.
La question du stockage d’énergie prend de l’ampleur : produire de l’hydrogène avec de l’électricité renouvelable et de l’eau ouvre d’innombrables usages. Piles à combustible, génération de chaleur, carburants de synthèse, applications spatiales, le champ des possibles s’élargit. Les investissements dans la recherche et le développement se multiplient, encouragés par les récentes analyses de la revue Nature Climate Change qui soulignent l’intérêt stratégique de l’hydrogène pour la transformation des systèmes énergétiques européens.
Les obstacles restent nombreux, mais voici les priorités concrètes pour structurer la filière :
- Réduire le coût de production et industrialiser l’électrolyse à grande échelle ;
- Organiser des chaînes logistiques fiables et adaptées ;
- Faire évoluer les infrastructures existantes pour le transport et l’injection de l’hydrogène dans les réseaux de gaz.
La France accélère, portée par l’élan européen et l’engagement de ses industriels. Chaque avancée, chaque innovation, façonne la promesse d’un avenir énergétique où la dépendance aux combustibles fossiles ne sera plus une fatalité, mais un souvenir en voie d’effacement.